
Qui sait à quel mirage nous convie le voyage?
Quelle illusion il génère?
On entre dans un voyage, parfois, comme dans un temps du rêve. Les perceptions sont intenses, les révélations, multiples; mais leur actualité est de faible amplitude. Et leur pertinence, souvent, réduite.
Le voyage voit à l’ouverture de potentialités nouvelles et de formes singulières. Et on se surprend d’y retrouver, à l’occasion, des figures qui nous ramènent à notre propre origine.
Mais n’est-ce pas là le mirage le plus dangereux? Celui qui nous fait redécouvrir au loin ce que nous connaissons déjà?
Premier mouvement
 Uluru.
Uluru.
C’est le cri du hibou au cœur de la nuit.
Un mythe de dieux anciens, issu de l’imagination d’un écrivain fiévreux.
Une créature aux yeux de sang et au pelage strié d’ocre et de noir.
Uluru!
Il faut le crier, ce nom, pour en entendre les échos sinistres et mélancoliques. Il traduit un sentiment de crainte face à un inconnu deux fois inconnu, car inconnu dans sa connaissance même.
Un mot à l’orée du langage.
Un mot aux limites de la lumière.
Lié au Temps du rêve et de la création.
*
Uluru!
Certains mots sont des énigmes qui font figure.
L’esprit s’arrête, étonné de retrouver dans le langage des formes qui répondent à ce que les sens ont entraperçu.
Existent-ils des mots qui parviennent à dire l’éblouissement au moment même où il survient?
Un mot argenté aux lignes brisées.
Les mots sont notre manière d’exister dans l’univers. Leur opacité est la marque de la complexité du monde, et de notre incapacité à le lire sans aide.
*
 Le mont Uluru au crépuscule s’impose par ses couleurs primaires et ses formes minimalistes. Pourtant, les émotions qu’il suscite sont étrangement surréalistes.
Le mont Uluru au crépuscule s’impose par ses couleurs primaires et ses formes minimalistes. Pourtant, les émotions qu’il suscite sont étrangement surréalistes.
Le mont frappe avec ses contours arrondis et assoupis. Le temps y apparaît ramolli, comme si la chaleur et l’odeur de poêlon surchauffé du désert venaient en perturber la saisie. On se croirait devant un paysage conçu par Dali ou de Chirico. Un paysage qui goûte le fer rouillé et le pourpre.
L’endroit paraît mystique, isolé dans un désert d’une grande aridité. La terre est d’un rouge oxydé, la chaleur est torride et les mouches collent au visage. Mais on se sent aspiré. Vers le plus lointain encore. Comme si le temps se mettait de la partie, s’ouvrant à l’immémorial.
*
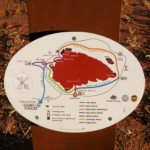 Certaines montagnes ressemblent à des animaux, à des éléphants étendus ou à des têtes de loup.
Certaines montagnes ressemblent à des animaux, à des éléphants étendus ou à des têtes de loup.
Vu du ciel, l’Uluru a la forme d’une pointe de flèche, faite dans la pierre et qui porte les marques du travail requis pour lui donner son tranchant. Une immense pointe de flèche déposée sur le sol rouge, qu’un géant pourrait à tout moment ramasser et attacher à une tige à l’aide de tendons de kangourou pour en faire une flèche.
Les paradoxes de Zénon d’Élée auraient pu naître aux pieds du mont Uluru. La flèche propulsée par un arc bandé ne rejoint jamais les bords lisses de la montagne. Elle se perd en chemin, s’égarant dans les entrelacs d’un temps qui se segmente et se rompt en îlots, atoll sans cohésion qui laisse filer entre les doigts les instants vécus et aussitôt oubliés.
*
Certains paysages sont d’une complexité assumée, les formes et les couleurs se multiplient, et il faut à l’œil du temps pour en intégrer les contours, pour transformer la masse de perceptions en un tableau vivant et cohérent.
Il n’en va pas de même avec le Mont Uluru dans les territoires du nord de l’Australie. C’est sa simplicité qui en fait la beauté. Une masse de pierre rouge, presque unie, si on oublie les blessures causées par l’érosion, un ciel d’un bleu uniforme, nullement ponctué par des nuages dissidents, et un sol composé de quelques arbres malingres et de buissons étouffés par la chaleur.
Rien de plus.
*
Si notre regard n’a pas à se battre avec un influx complexe de sensations et de formes, il se perd dans la densité des formes compactes du monolithe, et dans l’incandescence de l’orangé du soleil couchant et des ombres étirées que l’horizontalité presque parfaite de ses rayons provoque.
Le regard longe les rayons du soleil, il en suit les ondes et ne les confronte plus comme en plein jour. On ne se bat pas avec la lumière au crépuscule, on l’accompagne, on en épouse les formes, et on se laisse porter par le pinceau d’une étoile qui glisse sur la pierre pour en souligner la texture et les irrégularités.
*
Le Mont Uluru est une masse de pierre assoupie, comme une coulée de lave qui se serait immobilisée après une longue course. Sa forme endormie est apaisante, elle incite au recueillement, elle signale pourtant une intense activité géologique. Une force capable de faire émerger des entrailles de la terre des masses liquéfiées d’une pierre maintenant anesthésiée.
*
L’Uluru n’est pas un mont qu’on gravit, même s’il est possible de s’y aventurer quand les vents sont cléments et que le ciel est libre de tout orage.Son expérience est essentiellement visuelle. C’est une masse faite pour être contemplée de loin, pour être vénérée comme un dieu.
Son aura vient de la singularité d’une expérience visuelle d’une grande précision, celle des formes simples et des couleurs pleines.
Elle vient de son emplacement au milieu d’un désert inhospitalier, et d’un continent isolé dans les mers du sud.
Elle vient enfin de mes attentes comblées. Il ne peut y avoir de déception face à un tel panorama. Malgré ses innombrables représentations – les cartes postales, les brochures touristiques, les couvertures de livres –, le mont Uluru transcende ses copies et s’impose comme spécimen unique et comme expérience à éprouver dans sa singularité même.
