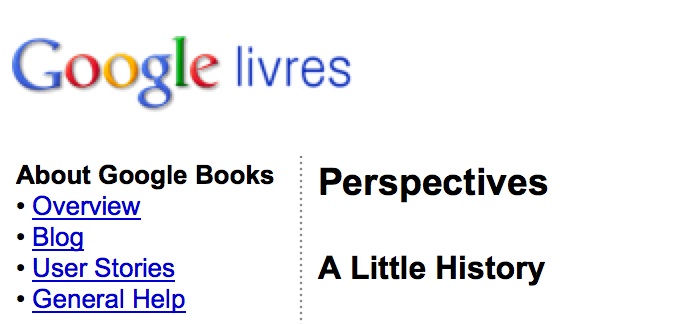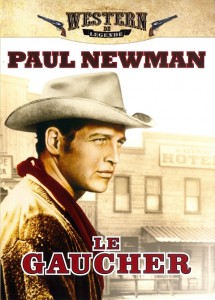À Georges et à Philippe, maître du désordre
En octobre 2014, le dieu Google s’est installé pendant trois jours consécutifs place Saint-Sulpice à Paris. À différents moments de la journée, il a pris des photos de ce qu’il voyait: les événements ordinaires de la rue, les gens, véhicules, animaux, nuages et le passage du temps. Les faits insignifiants de la vie quotidienne. Rien, ou presque rien. Mais un regard, une perception divine, unique, vibrante impressionniste, variable. Les innombrables variations imperceptibles du temps, de la lumière, du décor, du vivant. Autobus, chiens, passants, touristes. Après, il est remonté dans son Google Street Car et il est reparti. Vers la place des Vosges. Ou vers Clichy. On ne sait plus.
 La date 19 octobre 2014 (un dimanche, 40 ans plus tard)
La date 19 octobre 2014 (un dimanche, 40 ans plus tard)
L’heure 10 h. 45
Le lieu : Tabac Saint-Sulpice
Le temps : Pluie fine, genre bruine
Passage d’un balayeur de caniveaux
Par rapport à la veille, qu’y a-t-il de changé? Au premier abord, c’est vraiment pareil. Peut-être le ciel est-il plus nuageux? Ce serait vraiment du parti pris de dire qu’il y a, par exemple, moins de gens ou moins de voitures. On ne voit pas d’oiseau. Il y a un chien sur le terre-plein. Au-dessus de l’ Hôtel Récamier (loin derrière ?) se détache dans le ciel une grue (elle y était hier, mais je ne me souviens plus l’avoir noté). Je ne saurais dire si les gens que l’on voit sont les mêmes qu’hier, si les voitures sont les mêmes qu’hier? Par contre, si les oiseaux (pigeons) venaient (et pourquoi ne viendraient-ils pas) je serais sûr que ce seraient les mêmes.
Beaucoup de choses n’ont pas changé, n’ont apparemment pas bougé (les lettres, les symboles, la fontaine , le terre-plein, les bancs, l’église, etc.) ; moi-même je me suis assis à la même table.
 Des autobus passent. Je m’en désintéresse complètement.
Des autobus passent. Je m’en désintéresse complètement.
Le Café de la Mairie est fermé. Le kiosque à journaux aussi (il n’ouvrira que lundi).
(il me semble avoir vu passer Éric, se dirigeant vers le parking).
Passe une ambulance pimponnante, puis une dépanneuse remorquant une D.S. bleue.
Plusieurs femmes traînent des cabas à roulettes.
Arrivent les pigeons; ils me semblent moins nombreux qu’hier.
Afflux de foules humaines ou voiturières. Accalmies. Alternances.
Deux « Coches Parisiens » sortes de cars à plates-formes passent avec leurs cargaisons de Japonais photophages.
Un car Cityrama (des Allemands? des Japonais?) .
La pluie s’est arrêtée très vite ; il y a même eu pendant quelques secondes un vague rayon de soleil.
Il est 11 heures et quart.
A la recherche d’une différence.
 Le Café de la Mairie est fermé (je ne le vois pas; je le sais parce que je l’ai vu en descendant de l’ autobus).
Le Café de la Mairie est fermé (je ne le vois pas; je le sais parce que je l’ai vu en descendant de l’ autobus).
Je bois un Vittel alors que hier je buvais un café (en quoi cela transforme-t-il la Place?)
Le plat du jour de la Fontaine St-Sulpice a-t-il changé (hier c’était du cabillaud)? Sans doute, mais je suis trop loin pour déchiffrer ce qu’il y a écrit sur l’ardoise où on l’annonce.
Deux cars de touristes, le second s’appelle «Walz Reisen»: les touristes d’aujourd’hui peuvent-ils être les mêmes que les touristes d’hier (un homme qui fait le tour de Paris en car un vendredi a-t-il envie de le refaire le samedi ?)
Hier il y avait sur le trottoir, juste devant ma table, un ticket de métro; aujourd’hui il y a, pas tout à fait au même endroit, une enveloppe de bonbon (cellophane) et un bout de papier difficilement identifiable (à peu près grand comme un emballage de « Parisiennes » mais d’un bleu beaucoup plus clair).
Passe une petite fille avec un long bonnet rouge à pompon (je l’ai déjà vue hier, mais hier elles étaient deux) ; sa mère a une jupe longue faite de bandes de tissus cousues ensemble (pas vraiment du patchwork ).
Un pigeon se perche au sommet d’un lampadaire des gens entrent dans l’église (est-ce pour la visiter? Est-ce l’heure de la messe?).
Un promeneur qui ressemble assez vaguement à Éric Lint repasse devant le café et semble s’étonner de me voir encore attablé devant un Vittel et des feuillets.
Un car : « Percival Tours ».
D’autres gens entrent dans l’église.
Les cars de touristes n’adoptent pas tous la même stratégie : tous viennent du Luxembourg par la rue Bonaparte ; certains continuent dans la rue Bonaparte ; d’autres tournent dans la rue du Vieux-Colombier : cette différence ne correspond pas toujours à la nationalité des touristes.
Car Wehner Reisen.
Car de flics.
Il est temps que je retourne dans ma voiture.