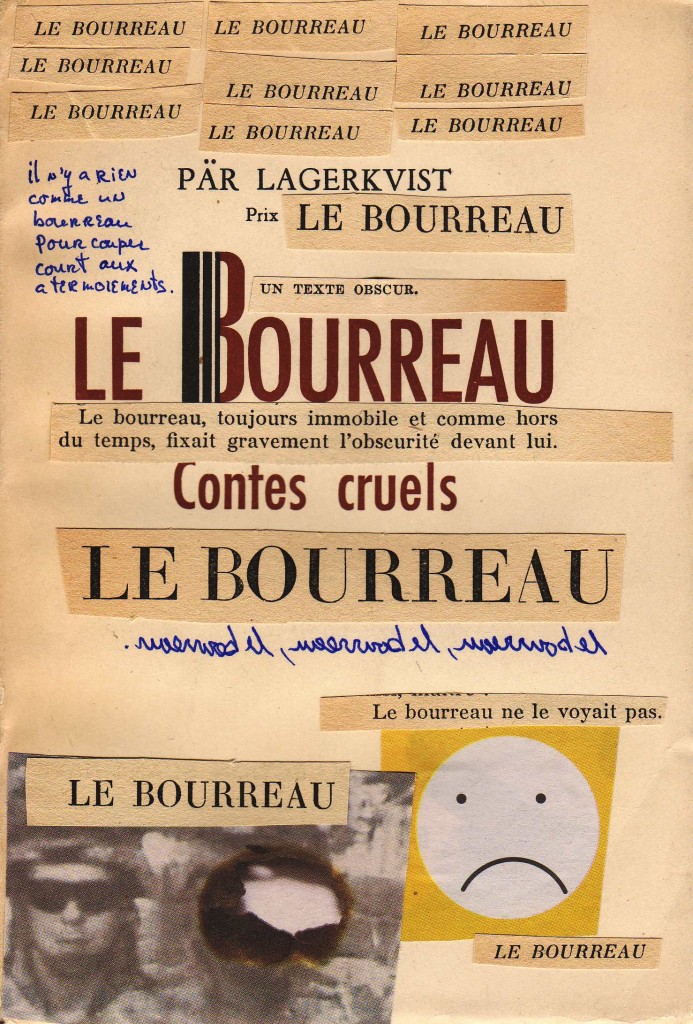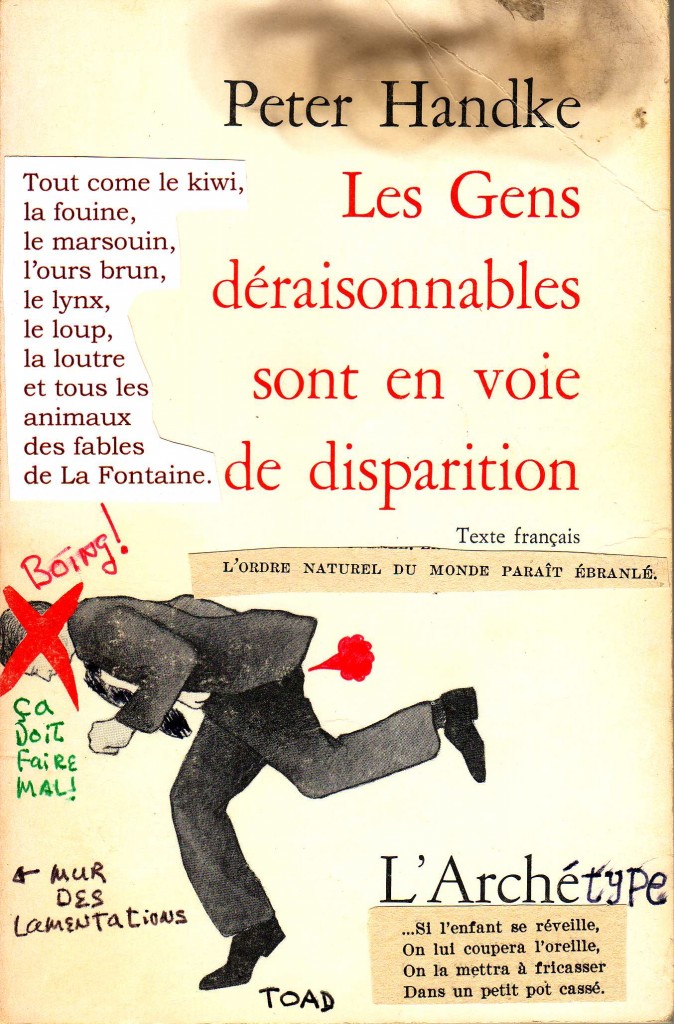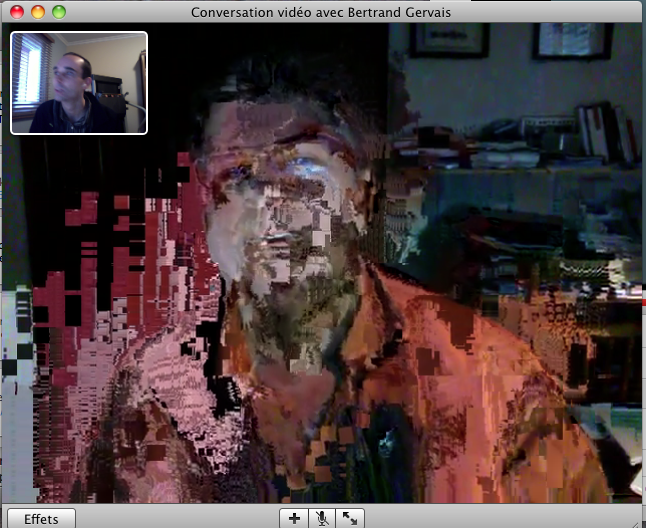Charles Ebbets, « Lunchtime atop a Skycraper », 1932.
Ne plus pouvoir s’extraire du réel.
C’est bien ce qui m’est arrivé cette année-là.
Je ne sais plus ce que j’ai fait le reste de cette journée du 11 septembre 2001. J’ai sûrement beaucoup parlé au téléphone. À mes amis et parents.
Nous avons eu, Allène et moi, de longs échanges infructueux sur ce que je devais faire. Les aéroports étaient fermés, les vols cloués au sol. Je me sentais comme un enfant entouré de ses valises qui attend à la porte de l’orphelinat que ses parents adoptifs viennent le recueillir. J’étais prêt à partir, mais aucune voiture ne s’arrêtait devant la grille.
En écoutant les bulletins de nouvelles, j’ai compris que le seul moyen de prendre l’avion était de me rendre à l’aéroport et d’y passer tout mon temps. Jour et nuit. Seuls les passagers désespérés recevaient l’autorisation de partir.
Je voulais que mon congé sabbatique commence enfin, j’avais déjà depuis quelques mois l’esprit ailleurs. Il n’était pas question que je reste à Montréal. C’aurait été un échec. Et il n’était pas question non plus que je laisse les événements décider de ma destinée. J’avais un roman à écrire. Des pages à remplir. Le onzième homme m’attendait. Et de pied ferme.
Il a fallu que je campe deux nuits de suite à l’aéroport avant de pouvoir gagner ma cause et d’embarquer sur un vol d’Air France.
L’atmosphère dans la cabine était fébrile. Étions-nous en sécurité? Quelque chose allait-il se passer? Les hôtesses de l’air multipliaient les vérifications, les cartes d’embarquement devaient être en tout temps visibles. Aucune file d’attente n’était permise aux abords des toilettes. Le repas fut servi froid.
Lire le reste de cet article »