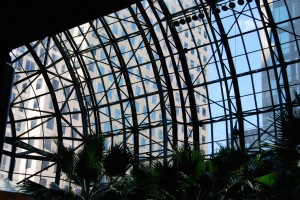J’ai négligé ce blog, depuis mon retour de New York, parce que la vie se faisait compliquée, et qu’il y avait plus important que les mots du 11 septembre. Ils étaient toujours là, en toile de fond, mais s’agitaient, devant, le deuil et la perte. Et puis il y a cette grève, qui ravage mon Québec étudiant, et qui donne lieu à des excès, des idioties, des violences, de la manipulation.
Des étudiants ont mis sur pied Fermaille, un “expiratoire de création”, un journal de grève. Je vous encourage à aller y jeter un coup d’oeil, ça vaut le détour. J’y publie tout juste un article, né de l’insomnie, que je reproduis ici:
Je suis inquiète. Tous les matins, j’ouvre les yeux et espère une résolution. Tous les matins, je crains de lire qu’un étudiant a été tué. Je ne dors plus. La nuit dernière, après une autre émeute fomentée non par vous, mes amis étudiants, mais bien par des fauteurs de trouble qui utilisent tous les prétextes pour « s’amuser » — en serions-nous là si le Canadien avait fait les séries? C’est une question idiote, je sais, mais imaginez, les émeutes quand le Canadien perd, quand il gagne, c’est peut-être quelque chose comme une soupape dont ont besoin les Black Bloc, qui expliquerait qu’ils se tournent maintenant vers les manifestations étudiantes? —, la nuit dernière, donc, je n’ai pas dormi. J’ai lu. Je suis retournée voir mon cher René, lire ses mots, parce qu’il a dit, avant que cela me paraisse évident, il a dit ce qui nous arrive à tous. René Lapierre, dans ses essais/poèmes, nous regarde tous nous débattre et lucidement, tendrement, nous dit :
« il n’y a pas trente-six moyens. Il ne s’agit plus de tenir, ni de lâcher. Quels sont vos commandements, d’où viennent vos ordres : faites attention, prenez soin, veuillez croire, et agréer, et recevoir, et cetera.
Il faut les lire pour ce qu’ils sont.
Les verbes chuchotent en secret des prières, raides de peur.
Les temps ne sont pas des temps mais des mondes : l’évidence des passés, la tendresse des futurs.
Tenir est un infinitif, il n’a rien dit de votre amour. » (Aimée soit la honte)
On parle de vous, dans les médias, et les mots me heurtent, à chaque instant, parce qu’ils disent à quel point on méprise le savoir, le futur. Vous êtes le futur, vous tous, que vous soyez pour ou contre la grève, vous qui travaillez 30, 40 heures pour survivre pendant vos études, vous qui, après 11 semaines de grève, êtes cernés, fatigués, usés par ces mêmes mots qui répètent à chaque jour, de toutes les façons possibles, que vos sacrifices ne comptent pas. Nous sommes un drôle de peuple, qui craint ses richesses, a honte de ses succès, préfère le statu quo au changement. Nous avons honte, oui, de demander mieux. Ce n’est pas nouveau : il fait si froid dehors que nous préférons encore vivre pétrifiés à l’intérieur, dans notre petit confort, de crainte que ce ne soit pire. Mais vous, étudiants, n’avez pas honte. On vous a dit gâtés, enfants-rois, profiteurs, riches. Vous répondez sagement, simplement, non. Vous expliquez la réalité de ce que vous êtes, vous tournez vers les politiques vos regards critiques, et vous dites Non. Non, nous n’accepterons pas le sabotage complet des gains du passé. Non, nous ne retournerons pas dans la noirceur où seuls les plus riches avaient accès à l’éducation. Non, nous ne vous croirons pas quand vous nous direz que nous devrions avoir honte de demander, d’exiger de vous qui êtes au pouvoir transparence, cohérence, respect.
J’ai, il n’y a pas si longtemps, fait parvenir à tous ceux qui se trouvaient dans mon carnet d’adresse un message accompagnant un document où avaient été colligés des témoignages de gens qui, comme moi, se sont endettés pour leurs études et qui, comme moi, payent le prix d’un système qui n’enrichit que les banques. Je signais : Annie Dulong, PhD, endettée et fière de l’être. On m’a demandé : pourquoi, fière de l’être? J’ai hésité. Et puis non, me suis-je dit. C’est bien là le nœud du problème. On veut que j’aie honte. On veut que je pense qu’il n’y a rien de pire que de croire qu’on peut, avec son savoir, ses connaissances, son éducation, apporter quelque chose à une société qui a plus que jamais besoin de gens capables de la penser. On veut que j’aie honte des années de vache maigre où la vache coutait franchement trop cher pour se trouver une place dans mon frigo. On veut que j’aie honte de cette pauvreté qui me poursuit depuis, à grands coups d’endettement et d’insécurité, parce que l’avenir des emplois permanents dont ont bénéficié les deux générations précédentes n’existe pas pour ma génération, pour la vôtre. Ils pouvaient réussir avec peu, se frayer un chemin à grand coup de travail, même sans éducation. Pas nous. La mobilité sociale n’existe plus vraiment pour nous, même avec une bonne éducation, nous sommes de la génération des précaires. Je suis endettée parce que j’y ai cru, à mon rôle dans cette société. Je suis endettée, et je me ré-endetterais demain matin, parce que je sais que nous tous qui nous battons aujourd’hui avons une voix. Je suis endettée, je n’en ai pas honte, mais je me demande, avec vous, s’il n’y aurait pas moyen de faire autrement.
Ici, on continue à avoir honte. Elle vient de si loin, la honte, des prêtres qui nous disaient que nous étions nés pour un petit pain, que vouloir mieux, que vouloir plus, était un péché. Ils voulaient que nous soyons tous sages, des prisonniers modèles d’un système qui ne pouvait se maintenir qu’en nous affaiblissant. Leur survie en dépendait, eux, les plus riches, qui collectionnaient églises et richesses sur le dos de leurs « brebis ». Vous, mes amis étudiants, êtes les enfants de ceux qui, pour la première fois, ont dit non. Ils ne s’en souviennent plus, le confort rend amnésique, mais ce sont eux qui ont dit aux prêtres, à la manière de Bartleby, « I would prefer not to ». Je préfèrerais ne pas travailler toute ma vie dans la peur. Je préfèrerais ne pas les croire quand ils me disent qu’une femme qui choisit ce qu’elle veut pour elle-même, pour son corps, commet un meurtre. Je préfèrerais ne pas les croire quand ils essaient de me faire taire, de me retirer ma voix, sous prétexte que je devrais écouter les « grands ». Je préfèrerais ne pas les laisser me retirer la possibilité d’avoir le choix, pour tout ce que je serai, plutôt que de devoir me reposer sur le déterminisme social.
Depuis le début, je suis inquiète, donc, parce que je les entends parler de vous comme si vous étiez encore des enfants, biberons à la bouche, alors qu’ils vous en demandent toujours plus, pour vous faire taire, vous ruiner de dettes, vous rendre dociles. Je suis inquiète, mais rassurée de vous voir aller, sans honte, carré rouge porté fièrement pour montrer que vous savez, d’une connaissance ancienne, que vous méritez mieux que l’îlot voyageur, les voyages en première classe des recteurs, les frais de fonctionnement qui ne paient que des cadres, rarement de nouveaux professeurs pour vous accompagner. Je m’inquiète des débordements, j’ai peur pour votre sécurité, et me rends compte que je ne crains pas de vous voir déborder, mais bien que ceux qui prétendent vouloir vous protéger réussissent à vous matraquer jusqu’au silence. Alors je me prends à espérer, en vous regardant, que vous saurez vous battre là où ma génération a baissé les bras trop vite. Que vous continuerez à utiliser les médias sociaux pour vous protéger des médias qui se disent objectifs mais ne voient que ce qu’ils veulent voir, n’entendent que ce qu’ils veulent entendre. J’espère, aussi, bien humblement, que vous savez à quel point vous êtes beaux dans cette force qui vous unit, dans cet avenir que vous nous donnez à voir.
Et j’espère que vous continuerez à vous bâtir un monde où nous dépasserons enfin le « I would prefer not to » de la honte et commencerons à dire « Nous méritons ceci ».