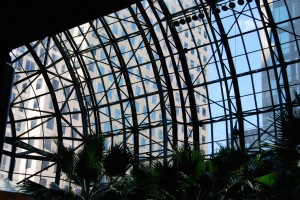Le 25 mai 2011, au Preview Site du National September 11 Memorial & Museum, avait lieu une conférence/table ronde avec Kathryn Olmsted et Michael Barkun. Sous le titre « 9/11 Conspiracy Theories : Why They Exist and What Role They Play in Society », l’événement avait pour but non pas de critiquer ou de questionner les théories du complot liées au 11 septembre, mais plutôt de réfléchir au concept même des théories du complet dans l’histoire et la société américaine. Ce n’était pas la première fois que j’assistais à une conférence au Preview Site. Il y a quelques mois, c’est le poète Peter Balakian qui était intervenu pour parler de la création littéraire après le 11 septembre. Dans les deux cas, les intervenants choisis par le Memorial & Museum ont pris garde de n’offenser personne. Dans les deux cas, j’ai senti à quel point ils savaient avancer en terrain miné. La question la plus dérangeante offerte a Balakian portait sur la nécessité même d’écrire sur le 11 septembre, après presque 10 ans. La plupart de ceux se trouvant dans la salle avaient déjà lu Balakian et aimaient et respectaient son œuvre.
Hier, la soirée ne s’est pas tout à fait déroulée de la même manière. Certes, il y avait dans la salle plusieurs membres du monde académique, la plupart des historiens. Le travail des conférenciers et du modérateur a été impeccable : ils ont retracé certaines des plus importantes théories de la conspiration, expliqué la différence entre théorie de la conspiration et conspiration, nommé certains théories de la conspiration qui ont permis de révéler de véritables conspirations, retracé des éléments propres aux théories de la conspiration du 11 septembre qui se retrouvent également dans d’autres théories de la conspiration. Leur but, très clair, était d’aborder la notion même de théories de la conspiration dans l’histoire américaine. D’expliquer qu’il y a eu de véritables conspirations, et que c’est de là que sont nées les théories de la conspiration. Les théories de la conspiration, selon eux, sont devenus des modèles à travers lesquels sont compris les événements historiques. Les théories de la conspiration permettent de donner un sens, une structure, au monde chaotique. Elles disent qu’il y a un plan, que le gouvernement américain sait tout, qu’il n’y a donc pas de hasard, pas d’arbitraire.
La discussion était fort intéressante en ce qu’elle permettait d’envisager les théories de la conspiration comme mouvement faisant partie de l’histoire et de la psyché américaine. Je savais, en regardant autour de moi, que cette vision plus académique de la notion ne passerait pas. Des hommes, à côté de moi, trépignaient, papiers en main. Ils n’écoutaient pas. Ils attendaient. Et dès que la discussion a été ouverte au public, ils se sont lancés.
Ils n’ont pas posé de questions. Ils ont plutôt tenté de piéger les conférenciers, de leur faire admettre que les théories de la conspiration du 11 septembre disent la vérité. Ils ont essayé d’inonder les conférenciers de faits, bribes d’informations qui, selon eux, disent tout. Leur discours était prévisible mais décevant. Ils ont détourné la discussion, utilisé la période de question comme faire-valoir : ils étaient ceux qui devaient être entendus; leur discours est la vérité; et tous autour qui en doutent les jugent. Le plus étonnant, c’était l’agressivité qu’ils démontraient, comme si l’heure de la conférence avait été une atteinte personnelle. Pourtant, aucun des conférenciers n’a porté de jugement sur les théoriciens de la conspiration. Olmstead a même dit, clairement, que le terme n’était pas péjoratif. Mais cela n’a rien donné : fidèles à deux des traits les plus importants des théories de la conspiration — l’art de n’admettre que certains aspects dans leur argumentation (omission et distorsion), la certitude indéfectible qu’ils ont raison —, les quelques hommes venus au Preview Site pour être entendus n’ont rien appris de la conférence.
C’était à la fois dommage et prévisible. Programmer une réflexion théorique sur la notion de théorie de la conspiration dans un lieu dont la fonction est de commémorer le 11 septembre et s’attendre à ce que la discussion puisse demeurer intellectuelle relève de l’utopie. Balakian, lors de sa visite, s’était empressé d’admettre qu’il se trouvait dans un lieu sacré (hallowed ground) pour se protéger, peut-être, de ceux qui verraient dans sa démarche une appropriation d’un événement qui leur appartient. Les conférenciers d’hier ont, comme Balakian, eut à se débattre contre cette appropriation du discours : ils ont été accusés, au bout du compte, de ne faire que répéter le discours officiel, d’être des pantins au service des pouvoirs établis. Lorsque, après l’annonce de la fin de la période de question, un homme s’est levé pour demander le droit de parole aux familles des victimes, il s’est érigé, par la perte de son oncle, en figure impossible à contester. Jusqu’au moment où, répondant à ses questions sur le WTC7, un homme, lui aussi faisant partie des familles des victimes, a simplement dit que le problème du 7, c’est qu’on avait construit un immeuble de 40 étages sur des fondations qui ne pouvaient soutenir que 20 étages.
Évidemment, l’autre ne l’a pas cru.