La traversée de la bande dessinée
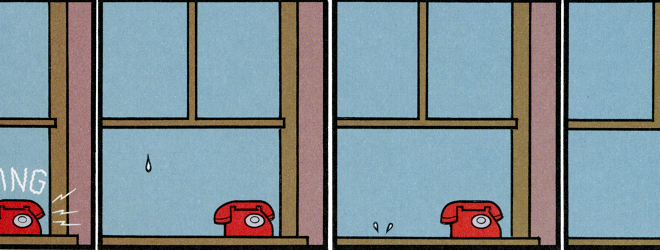
Longtemps, la bande dessinée a été associée à son genre dominant (la littérature jeunesse), qui discréditait, aux yeux de plusieurs, sa valeur artistique intrinsèque. Ainsi, bien qu’elle semble acquise aujourd’hui, la légitimation du 9e art au sein du monde universitaire demeure relativement récente1. La critique, en Europe du moins, s’est développée au sein des premières revues de bande dessinée pour adultes : par conséquent, comme le note Catherine Saouter, « le discours sur la BD [a longtemps côtoyé], et de très près – dans le même espace physique – les productions esthétiques elles-mêmes2. » L’histoire critique de la bande dessinée est parsemée de malentendus : genre confondu avec le médium, critique côtoyant la création. Ainsi, même comparée aux arts qui lui sont contemporains – comme le cinéma –, la bande dessinée semble souffrir d'un manque d'études fondatrices, et la méthode pour l’étudier est loin de faire l'unanimité. À l'aube du millénaire, Thierry Groensteen constatait :
Les ouvrages qui ont vraiment aidé à la compréhension du phénomène bande dessinée sont en nombre très limité, et la légitimation relative du « 9e art » en France n'a pas vraiment entraîné leur multiplication. L'érudition myope, la nostalgie et l'idolâtrie ont inspiré l'essentiel des discours tenus autour de la bande dessinée depuis environ trois décennies3.
Trop souvent encore, la théorie est ignorée par la critique, exacerbant ainsi la disparité des concepts et des vocabulaires utilisés. Dans un tel contexte, les prémisses théoriques d’une analyse de bande dessinée – même aux ambitions modestes – ne sauraient être convenues ni implicites, comme cela peut arriver en études littéraires. Celles du présent ouvrage seront déterminées par deux contraintes de corpus : en aval, par l'œuvre de Chris Ware, qui, bien que remarquablement riche, ne couvre pas toutes les potentialités du médium; en amont, par le choix d'un ouvrage théorique de référence, le Système de la bande dessinée de Thierry Groensteen. Le Système de la bande dessinée se développe à ce jour en deux tomes, publiés en 2000 et en 2011. Le plus récent, intitulé Bande dessinée et narration4, peut être considéré comme un complément du premier, où les bases théoriques les plus importantes sont posées. Aussi ce chapitre fera-t-il généralement référence au premier tome, sauf lorsqu’il s’agira d’aborder les questions de la mise en page et de la narration.
Choisir Groensteen n'implique pas un oubli des autres théoriciens importants de la bande dessinée : Morgan, Beatens, Peeters, Marion et McCloud auront tous influencé le présent travail. Néanmoins, le Système de Groensteen s'impose comme référence, ne serait-ce qu’au point de vue terminologique. D'une part, étant plutôt récent, il propose une synthèse des idées qui le précèdent et préconise un héritage théorique constructif – plutôt que destructif. D'autre part, comme le présent travail, le Système s’inscrit dans une approche sémiologique de la bande dessinée5. Finalement, il faut souligner l'importance toute particulière que Groensteen accorde à la question de l’espace en bande dessinée. La nomenclature spatiale du Système, fondée sur la prégnance de la vignette et des cadres, semble trouver chez Chris Ware un corpus de prédilection.
- 1. Sérieusement entamée dans les années 1970, grâce à Pierre Fresnault-Deruelle notamment, l’étude de la bande dessinée a connu son premier rassemblement majeur en 1987 avec le colloque de Cerisy « Bande dessinée, récit et modernité », dirigé par Thierry Groensteen.
- 2. Catherine Saouter. 1990. La bande dessinée québécoise (1979-1984) : Éléments pour une sémiologie de la bande dessinée.
- 3. Thierry Groensteen. 1999. Système de la bande dessinée, p. 1. Dorénavant, les références à cet ouvrage seront indiquées entre parenthèses, précédées de la mention S1.
- 4. Thierry Groensteen. 2011. Bande dessinée et narration : Système de la bande dessinée 2. Dorénavant, les références à cet ouvrage seront indiquées entre parenthèses, précédées de la mention S2.
- 5. « La bande dessinée sera considérée ici en tant que langage, c'est-à-dire non pas comme le phénomène historique, sociologique et économique qu'elle est par ailleurs, mais comme un ensemble original de mécanismes producteurs de sens. » (S1, 2)


