L’espace de l’imaginaire
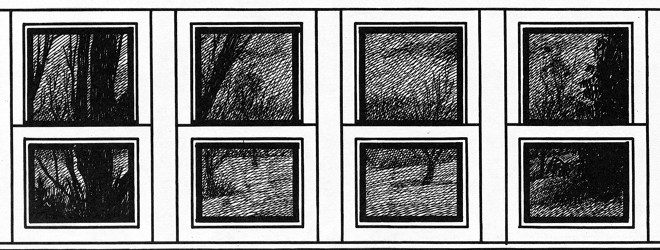
La notion d'espace en cache plusieurs autres. La distance, la surface, la taille, le haut, le bas et le lieu font partie de ces paramètres spatiaux qui gouvernent notre cognition, définissent les objets qui nous entourent. Dans Espace, temps, prépositions, Tijana Ašić observe que le langage privilégie généralement les prépositions spatiales aux prépositions purement temporelles… même lorsqu'il s'agit d'évoquer le temps lui-même1. Cela tient, toujours d'après Ašić, à ce que l'espace offre davantage de dimensions perceptibles (trois) que le temps, pouvant ainsi accueillir une plus grande variété de relations2. Notons que, malgré son caractère physiquement3 unidimensionnel, le temps a connu plusieurs modélisations – l'étude des régimes d'historicité de François Hartog peut en témoigner4. Or, ces modélisations suggèrent, du moins dans leur expression contemporaine, un imaginaire géométrique : temps cyclique (cercle), temps linéaire (ligne), présentisme (point). Ainsi, les dimensions spatiales semblent servir d’ancrage sémantique à certains concepts temporels, et rarement l’inverse. Pour étudier les rapports entre mémoire et architecture, cette projection du temps dans l’espace annonce de belles découvertes. Or, comment appréhender ce phénomène du point de vue de l’imaginaire, en l’affranchissant des études cognitives, dont les ambitions dépassent largement ce travail?
- 1. « [Notre hypothèse] postule que les expressions spatiales sont sémantiquement et grammaticalement fondamentales et qu’elles servent à décrire non seulement les relations spatiales mais aussi d’autre [sic] types de relations, notamment les relations temporelles. » Tijana Ašić. 2008. Espace, temps, prépositions, p. 11.
- 2. Tijana Ašić. 2004. La représentation cognitive du temps et de l’espace : étude pragmatique des données linguistiques en français et dans d’autres langues, p. 32-33.
- 3. La Physique connaît elle-même ses célèbres modèles temporels, du temps universel de Newton à la relativité d’Einstein. Nous pouvons néanmoins affirmer que, depuis plusieurs siècles, l’imaginaire newtonien prédomine en occident, du moins à l’échelle des phénomènes terrestres.
- 4. François Hartog. 2002. Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps.


